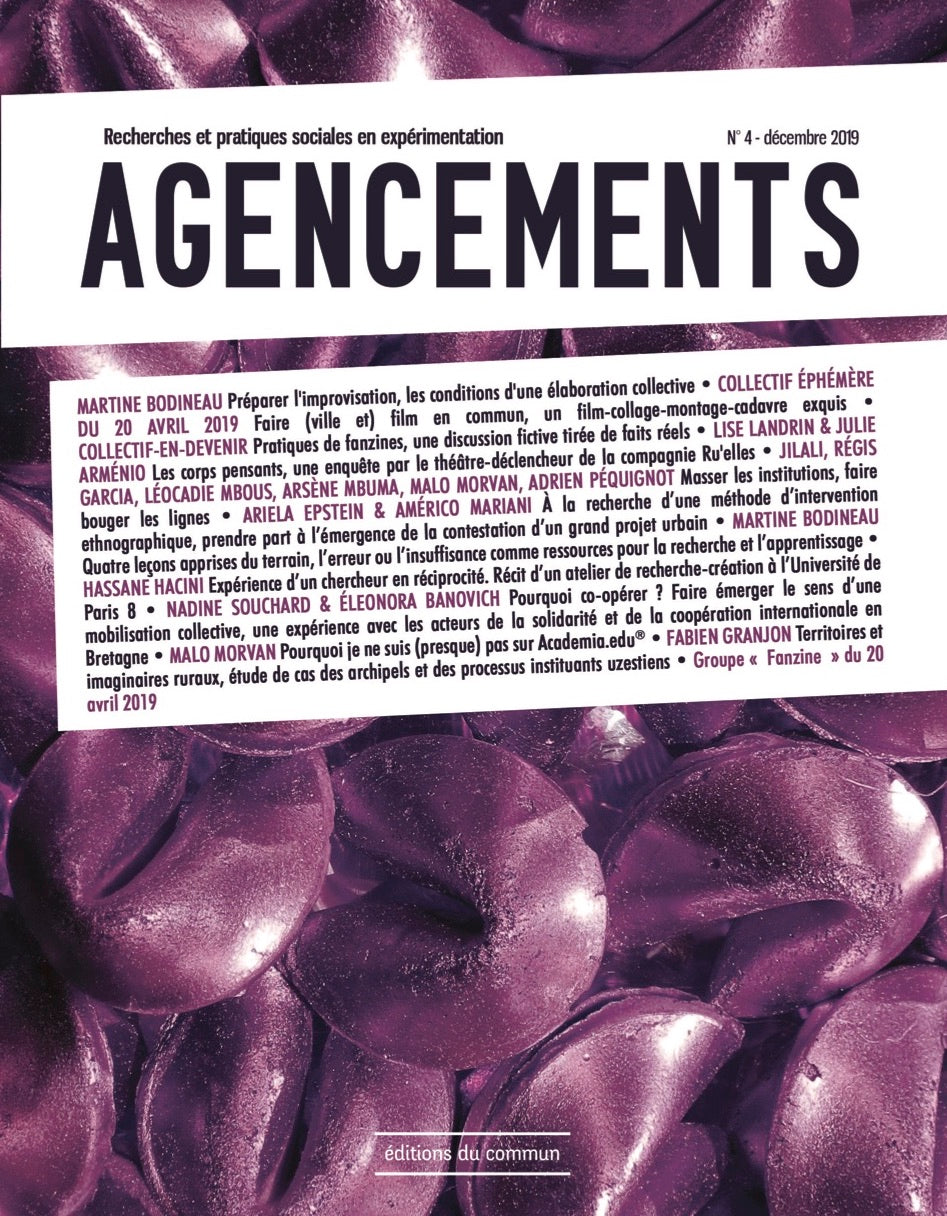Agencements n°4 – décembre 2019
Recherches et pratiques sociales en expérimentation
Collectif
| Parution | 12/12/2019 |
|---|---|
| Format | Livre broché de 248 pages |
| ISBN | 979-10-95630-30-2 |
| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |
SOMMAIRE
LA RECHERCHE EN FABRICATION
MARTINE BODINEAU
Préparer l’improvisation, les conditions d’une élaboration collective
COLLECTIF EPHEMERE DU 20 AVRIL 2019
Faire (ville et) film en commun, un film-collage-montage-cadavre exquis
COLLECTIF-EN-DEVENIR
Pratiques de fanzines, une discussion fictive tirée de faits réels
VILLES ET CORPS EN RECIT
LISE LANDRIN ET JULIE ARMENIO
Les corps pensants, une enquête par le théâtre-déclencheur de la compagnie Ru’elles
JILALI, REGIS GARCIA, LEOCADIE MBOUS, ARSENE MBUMA, MALO MORVAN, ADRIEN PEQUIGNOT
Masser les institutions, faire bouger les lignes
ARIELA EPSTEIN ET AMERICO MARIANI
À la recherche d’une méthode d’intervention ethnographique, prendre part à l’émergence de la contestation d’un grand projet urbain
L’EXPERIMENTATION OU LE PARTAGE DES SAVOIRS
MARTINE BODINEAU
Quatre leçons apprises du terrain, l’erreur ou l’insuffisance comme ressources pour la recherche et l’apprentissage
HASSANE ACINI
Expérience d’un chercheur en réciprocité. Récit d’un atelier de recherche-création à l’Université de Paris
NADINE SOUCHARD ET ELEONORA BANOVICH
Pourquoi co-opérer ? Faire émerger le sens d’une mobilisation collective
MALO MORVAN
Pourquoi je ne suis (presque) pas sur Academia.edu®
COULISSES
FABIEN GRANJON
Territoires et imaginaires ruraux, étude de cas des archipels et des processus instituants uzestiens
BONUS
GROUPE « FANZINE » DU 20 AVRIL 2019
« Faire la ville en commun »