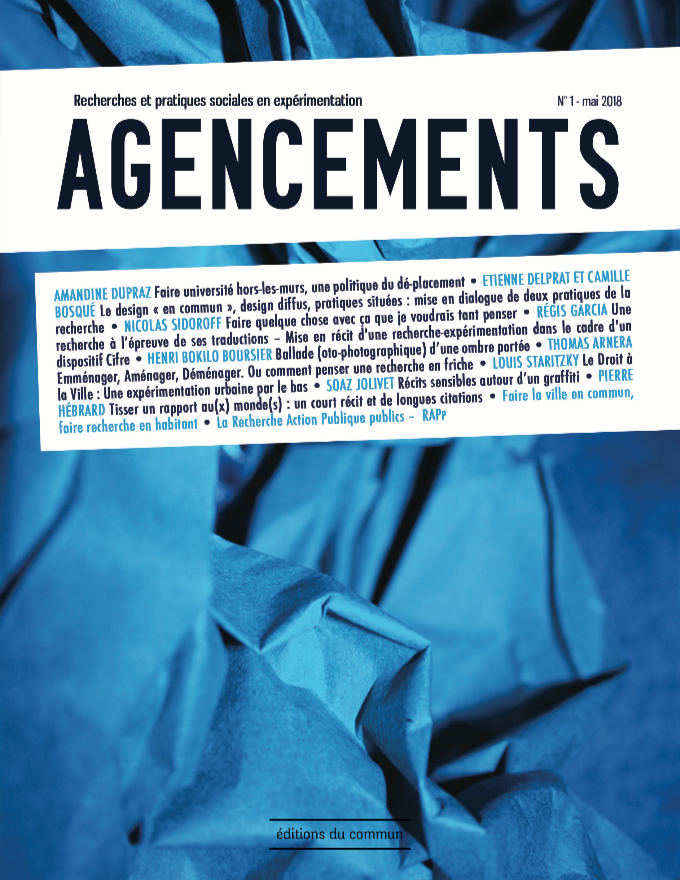Agencements n°1 – mai 2018
Recherches et pratiques sociales en expérimentation
Collectif
| Parution | 18/05/2018 |
|---|---|
| Format | Livre broché de 204 pages |
| ISBN | 2608-5739 |
| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |
SOMMAIRE
FAISANT RECHERCHE
AMANDINE DUPRAZ
Faire université hors-les-murs, une politique du dé-placement
ÉTIENNE DELPRAT ET CAMILLE BOSQUÉ
Design diffus, pratiques situées, design (en-)commun : au fil d’un bricolage conceptuel et méthodologique
NICOLAS SIDOROFF
Faire quelque chose avec ça que je voudrais tant penser
RÉGIS GARCIA
Une recherche à l’épreuve de ses traductions, mise en récit d’une recherche-expérimentation dans le cadre d’un dispositif Cifre
TRANSVERSE
HENRI BOKILO BOURSIER
Ballade (oto-photographique) d’une ombre portée
EXPLORANT LA VILLE
THOMAS ARNERA
Emménager, Aménager, Déménager, ou comment penser une recherche en friche
LOUIS STARITZKY
Le Droit à la Ville : Une expérimentation urbaine par le bas
SOAZ JOLIVET
Récits sensibles autour d’un graffiti
PARCOURS
PIERRE HÉBRARD
Tisser un rapport au(x) monde(s) : un court récit et de longues citations
COULISSES
Faire la ville en commun, faire recherche en habitant La Recherche Action Publique publics – RAPP
________________________________________________________
Les Fabriques de sociologie est un réseau de recherche en sciences sociales, créé en 2012, qui associe des acteur-es d’horizons différents (chercheur-es statutaires, indépendant-es ou précaires, professionnel-les hybrides articulant la recherche en sciences sociales avec des pratiques artistiques ou architecturales, avec des engagements citoyens, avec des activités d’intervention sociale ou d’éducation populaire politique…) dans la perspective d’une recherche critique en capacité de lutter contre les discriminations, de renforcer la faculté à agir des minoritaires et des dominé-es et de promouvoir une « méthode de l’égalité » en termes de coopération, de co-création et de démocratie. En ligne : http://www.fabriquesdesociologie.net/.