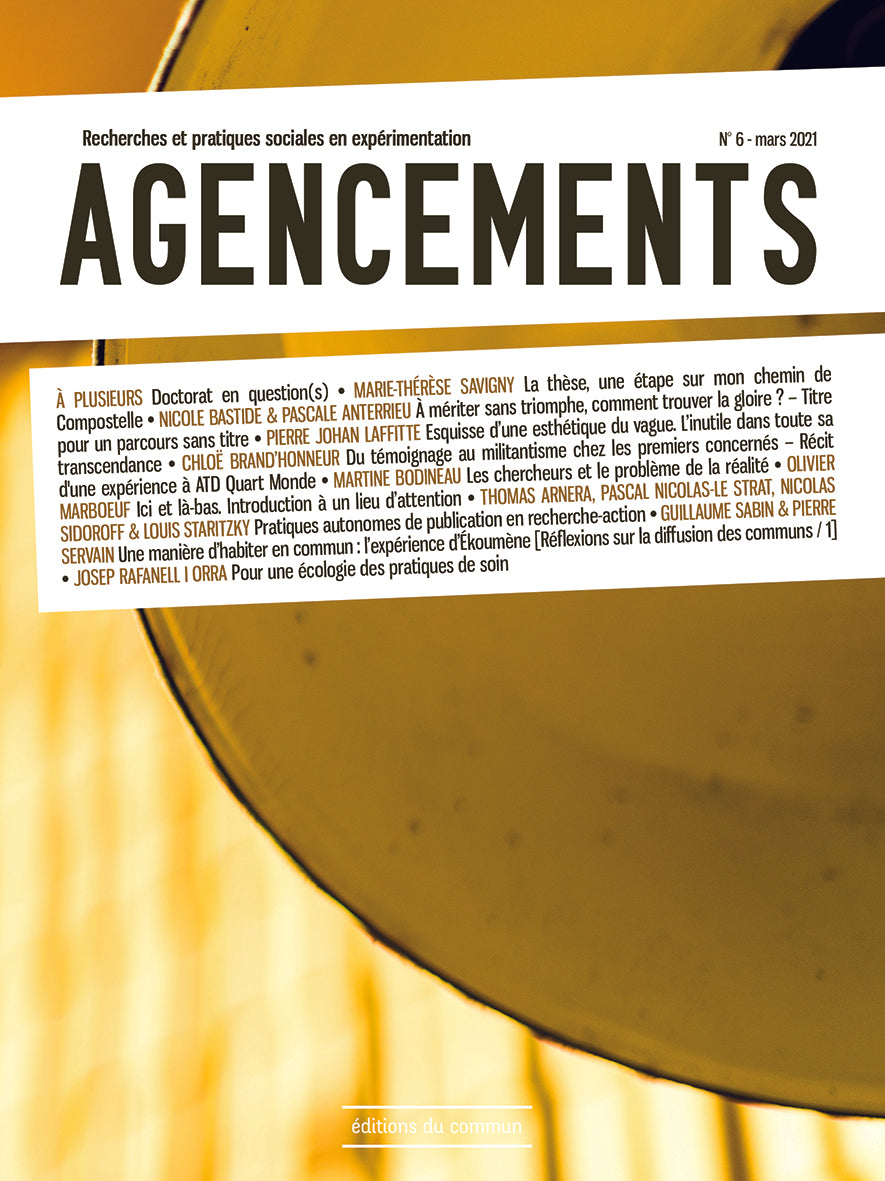Agencements n°6 – avril 2021
Recherches et pratiques sociales en expérimentation
Collectif
| Parution | 16/04/2021 |
|---|---|
| Format | Livre broché de 182 pages |
| ISBN | 979-10-95630-40-1 |
| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |
SOMMAIRE
DÉSIRER - RECHERCHE ET INSTITUTIONS
Doctorat en question(s)
Marie-Thérèse SAVIGNY
La thèse, une étape sur mon chemin de Compostelle
Nicole BASTIDE, Pascale ANTERRIEU
À mériter sans triomphe, comment trouver la gloire ? – Titre pour un parcours sans titre
DÉCODER – RÉALITÉS CONSTRUITES, ASSIGNATIONS DÉJOUÉES
Pierre Johan LAFFITTE
Esquisse d’une esthétique du vague. L’inutile dans toute sa transcendance
Chloé BRAND’HONNEUR
Du témoignage au militantisme chez les premiers concernés - Récit d'une expérience à ATD Quart Monde
Martine BODINEAU
Les chercheurs et le problème de la réalité
RECOMPOSER – COMMUNAUTÉS LATÉRALES, EXPÉRIMENTATIONS VIVES
Olivier MARBOEUF
Ici et là-bas. Introduction à un lieu d’attention
Thomas ARNERA, Pascal NICOLAS-LE STRAT, Nicolas SIDOROFF et Louis STARITZKY
Pratiques autonomes de publication en recherche-action
Guillaume SABIN, Pierre SERVAIN
Une manière d’habiter en commun : l’expérience d’Ékoumène [Réflexions sur la diffusion des communs / 1]
Josep RAFANELL I ORRA
Pour une écologie des pratiques de soin