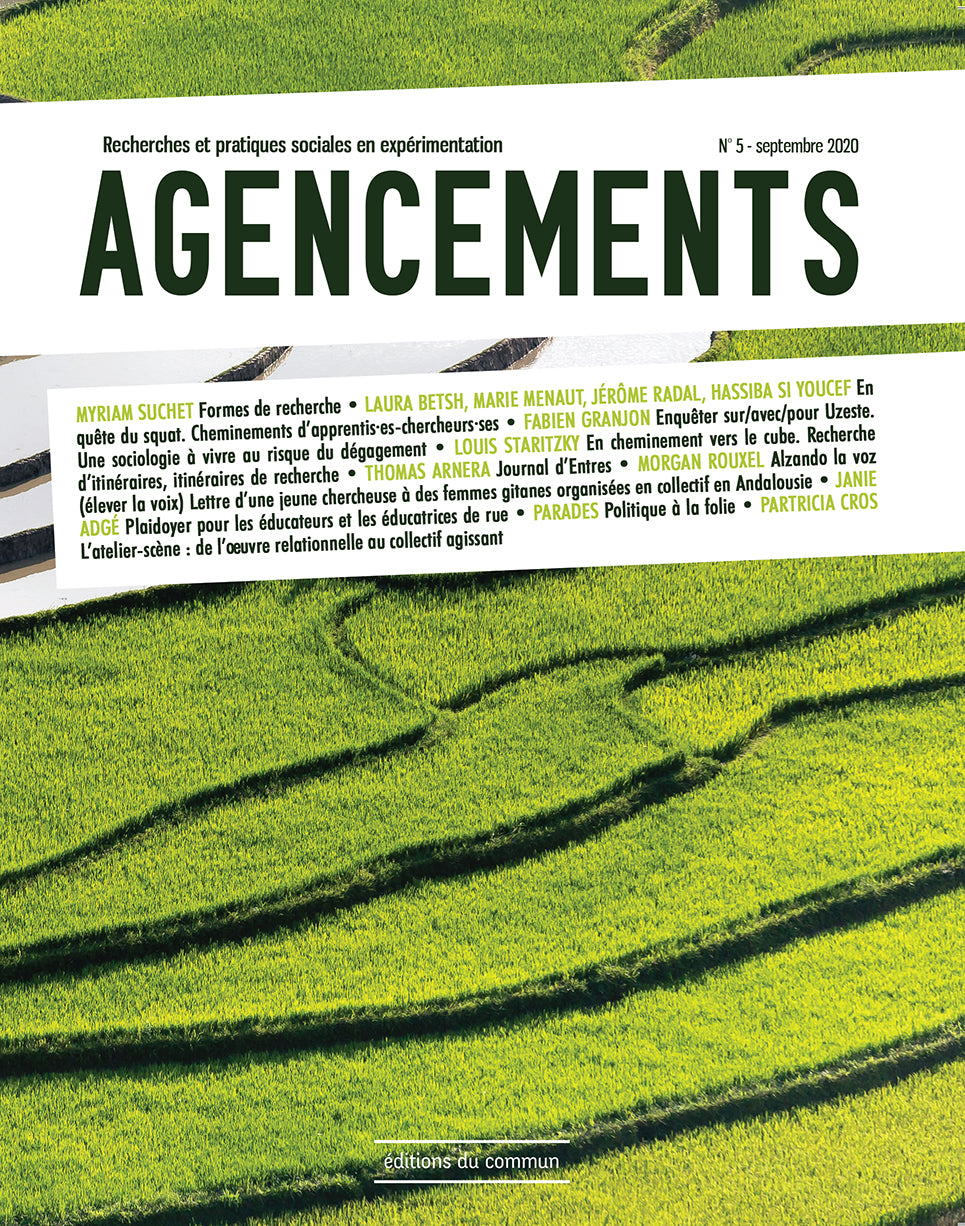Agencements n°5 – septembre 2020
Recherches et pratiques sociales en expérimentation
Collectif
| Parution | 11/09/2020 |
|---|---|
| Format | Livre broché de 224 pages |
| ISBN | 979-10-95630-34-0 |
| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |
SOMMAIRE
MYRIAM SUCHET
Formes de recherche
RETOUR SUR RECHERCHE
LAURA BETSCH, MARIE MENAUT, JÉRÔME RADAL, HASSIBA SI YOUCEF
En quête du squat. Cheminements d’apprentis.es – chercheurs.ses
FABIEN GRANJON
Enquêter sur/avec/pour Uzeste. Une sociologie à vivre au risque du dégagement
LOUIS STARITZKY
En cheminement vers le cube. Recherche d’itinéraires, Itinéraires de recherche
THOMAS ARNERA
Journal d'entres
ADRESSER LA RECHERCHE
MORGAN ROUXEL
Alzando la voz (élever la voix). Lettre d'une jeune chercheuse à des femmes organisées en collectif en Andalousie
JANIE ADGÉ
Plaidoyer pour les éducateurs et éducatrices de rue
PARADES
Politique à la folie
PATRICIA CROS
L'atelier-scène : de l’œuvre relationnelle au collectif agissant