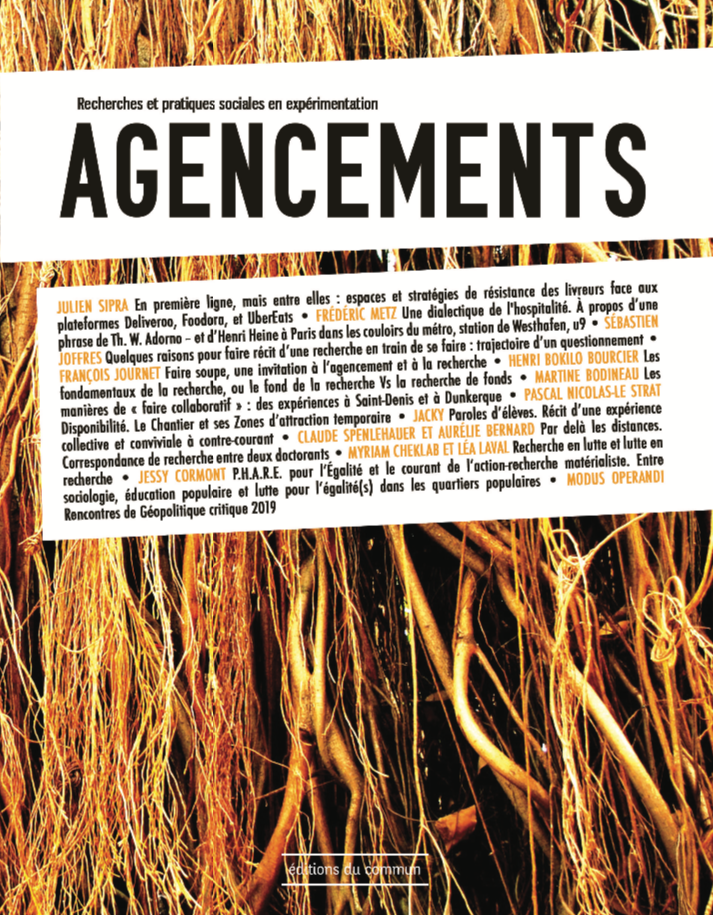Agencements n°3 – juin 2019
Recherches et pratiques sociales en expérimentation
Collectif
| Parution | 14/09/2019 |
|---|---|
| Format | Livre broché de 204 pages |
| ISBN | 979-10-95630-23-4 |
| Consulter et télécharger sur Cairn.info | |
SOMMAIRE
PARTIR EN QUÊTE, MENER L'ENQUÊTE
JULIEN SIPRA
En première ligne, mais entre elles : espaces et stratégies de résistance des livreurs face aux plateformes Deliveroo, Foodora, et UberEats
FRÉDÉRIC METZ
Une dialectique de l'hospitalité. À propos d’une phrase de Th. W. Adorno – et d’Henri Heine à Paris dans les couloirs du métro, station de Westhafen, u9
SÉBASTIEN JOFFRES
Quelques raisons pour faire récit d’une recherche en train de se faire : trajectoire d’un questionnement
FRANÇOIS JOURNET
Faire soupe, une invitation à l’agencement et à la recherche
TRANSVERSE
HENRI BOKILO BOURCIER
Les fondamentaux de la recherche, ou le fond de la recherche Vs la recherche de fonds
ÊTRE AVEC, FAIRE AVEC
MARTINE BODINEAU
Les manières de « faire collaboratif » : des expériences à Saint-Denis et à Dunkerque
PASCAL NICOLAS-LE STRAT
Disponibilité. Le Chantier et ses Zones d’attraction temporaire
JACKY
Paroles d’élèves. Récit d’une expérience collective et conviviale à contre-courant
PARCOURS
CLAUDE SPENLEHAUER et AURÉLIE BERNARD
Par delà les distances. Correspondance de recherche entre deux doctorants
ENGAGER LA RECHERCHE, S'ENGAGER EN RECHERCHE
MYRIAM CHEKLAB et LÉA LAVAL
Recherche en lutte et lutte en recherche
JESSY CORMONT
P.H.A.R.E. pour l’Égalité et le courant de l’action-recherche matérialiste. Entre sociologie, éducation populaire et lutte pour l’égalité(s) dans les quartiers populaires
MODUS OPERANDI
Rencontres de Géopolitique critique 2019